Des Identités aux -Ismes : Déconstruire les Mythes Interculturels
Résumé de section
-
Ce chapitre propose une analyse critique des interculturologies, notamment l’identité, la compétence interculturelle et l'internationalisation. À travers des discussions étymologiques et des exemples de mythes associés à ces concepts, l’auteur interroge leur construction et leur usage en recherche et en éducation. Des revues de littérature internationale permettent de démystifier ces idéologies, invitant le lecteur à adopter une posture critique et réflexive face à ces notions complexes.
-

Le concept d'identité est souvent perçu à travers des mythes simplificateurs, tels que l’idée que l’identité est fixe, homogène ou qu’elle reflète uniquement des traits biologiques. Pourtant, la recherche interculturelle contemporaine démontre que l'identité est en réalité fluide, contextuelle et constamment façonnée par nos interactions avec les autres. Ainsi, elle ne peut jamais être totalement figée ou isolée des influences sociales et culturelles.
-

Le concept d'inclusion est souvent déformé par des mythes, tels que l’idée que l’inclusion équivaut à l’assimilation ou qu’elle est dictée unilatéralement par les « locaux ». L’étymologie du terme, issue du latin pour « enfermer » ou « enclore », révèle d'ailleurs une tension interne : inclure, à l'origine, signifiait également exclure.
-

La notion d'idéologie dans le domaine de l'éducation et de la recherche sur la communication interculturelle met en lumière le rôle omniprésent et inévitable des idéologies dans la manière dont nous comprenons, pratiquons et enseignons l'interculturalité. L'auteur commence par déconstruire certains mythes sur les idéologies, notamment l'idée fausse selon laquelle certaines approches seraient purement scientifiques, non idéologiques, ou que les idéologies seraient immuables. Au contraire, l'auteur affirme que les idéologies sont dynamiques et souvent dissimulées derrière des prétentions d'objectivité ou de neutralité.
-

La dichotomie problématique entre individualisme et collectivisme dans la recherche et l'éducation interculturelles est un concept souvent simplifié et propagé à travers des stéréotypes. L'auteur critique cette opposition binaire, affirmant qu'il s'agit plutôt d'un continuum où chaque société et individu navigue entre ces deux idéologies. L'individualisme est souvent célébré en tant que vertu, particulièrement dans les sociétés occidentales, tandis que le collectivisme est fréquemment mal interprété ou rejeté, renforçant ainsi l'ethnocentrisme et les généralisations culturelles.
-

L'idée d'intégration souligne ses aspects problématiques, notamment sa politisation et la simplification de ses critères, souvent réduits à des tests linguistiques ou culturels. L'intégration est souvent perçue comme un processus unidirectionnel où les nouveaux arrivants doivent s'adapter à la société dominante, ce qui implique souvent de "se fondre" dans la majorité. Cependant, cette approche ne prend pas en compte la complexité et l'instabilité du sentiment d'intégration, ni les expériences individuelles qui varient en fonction du contexte.
-

Le concept de compétence interculturelle est largement discuté dans la recherche, souvent fondé sur des idéologies néolibérales et capitalistes, notamment l’idée de contrôle et d’efficacité. Il souligne que ce concept a émergé principalement des États-Unis et du Royaume-Uni, et qu'il repose sur des présupposés occidentaux qui se présentent comme universels, mais qui sont en réalité biaisés et idéologiquement orientés.
-
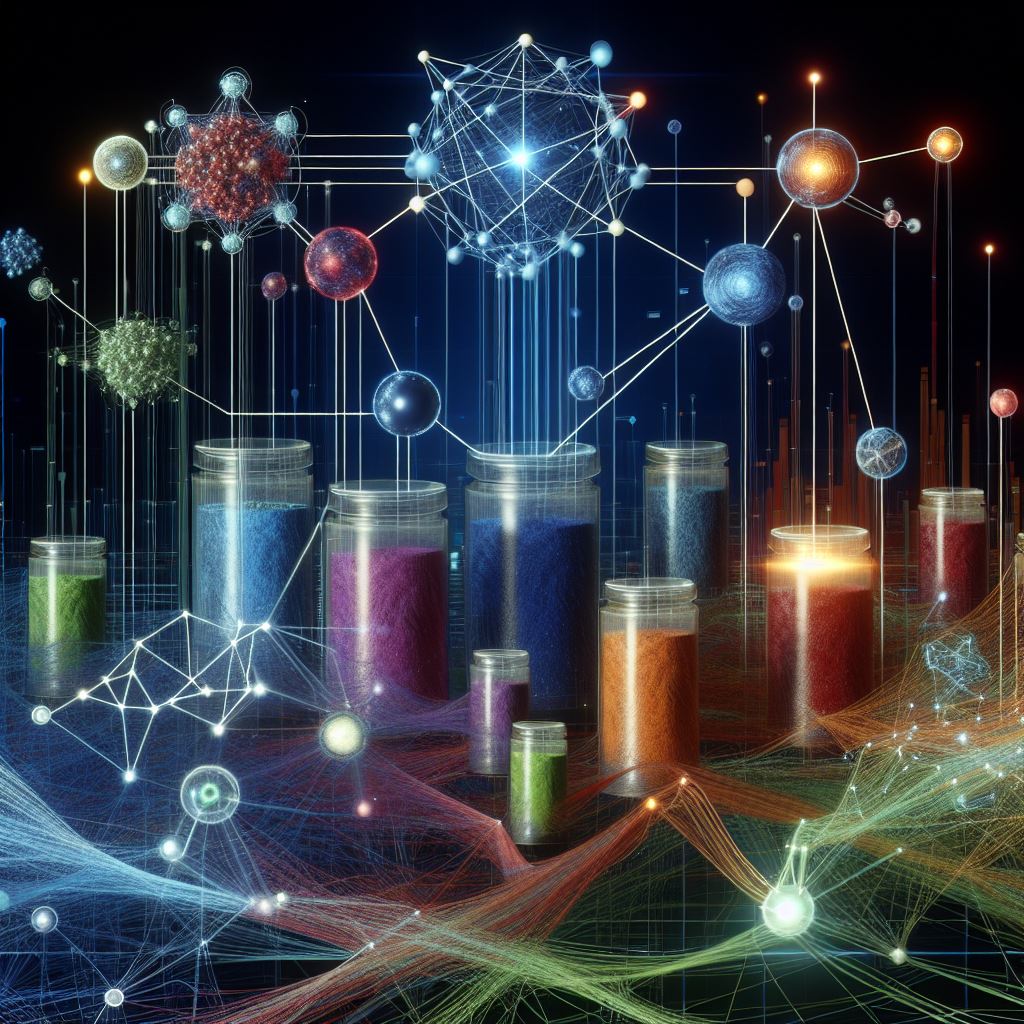
L’interdisciplinarité critique certaines idées reçues sur le sujet, notamment l’idée que l’interdisciplinarité est facile à établir, qu’elle garantit innovation et succès, ou qu’une seule discipline peut résoudre certains problèmes scientifiques. Il présente l’interdisciplinarité comme un concept complexe, souvent mal compris et utilisé de manière superficielle dans de nombreux cas.
-
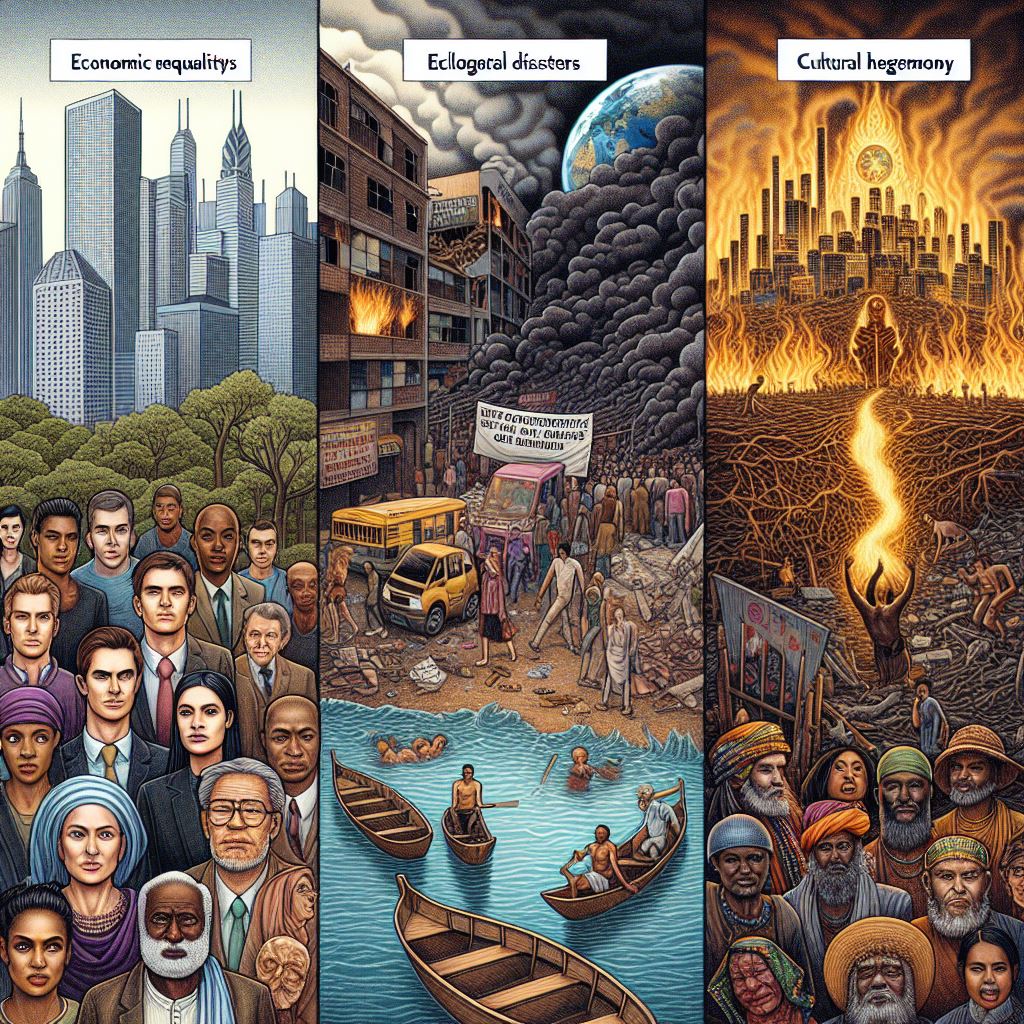
L'internationalisation de l'enseignement supérieur est un phénomène complexe et multidimensionnel, souvent idéalisé à travers certains mythes. Parmi eux, l'idée que l'internationalisation est toujours bénéfique, que seule la mobilité étudiante à l'étranger est importante, ou encore que l'anglais domine l'éducation internationale. En réalité, ces idées simplifient une dynamique bien plus nuancée.
-
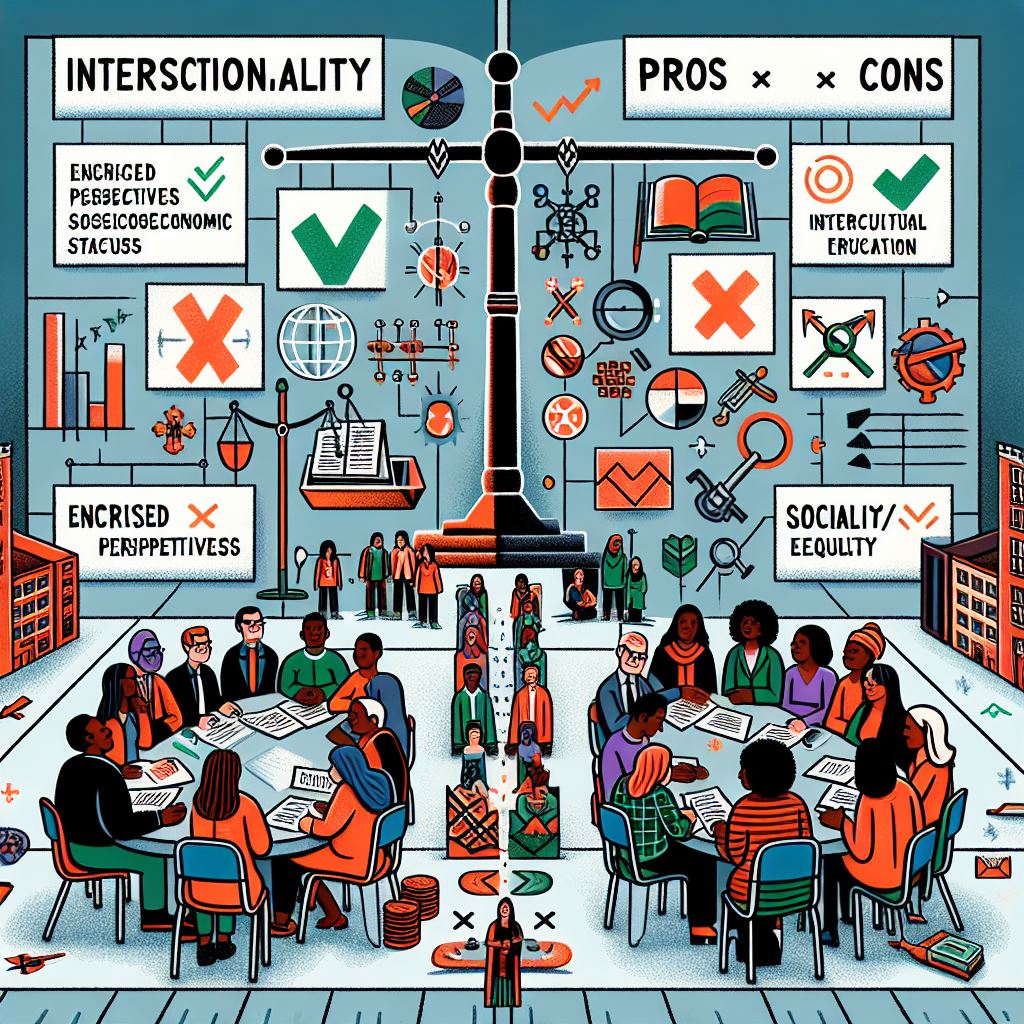
L'intersectionnalité est un cadre conceptuel issu de la théorie critique de la race, qui examine la nature interconnectée des catégories sociales telles que la race, le genre, la classe, la sexualité et le handicap. Développé par la juriste Kimberlé Crenshaw dans les années 1980, ce concept vise à analyser comment ces différentes identités interagissent et influencent l'accès au pouvoir, aux ressources et aux opportunités. Contrairement à certaines idées reçues, l'intersectionnalité ne se limite pas à une liste de marqueurs identitaires, mais souligne la complexité et la multiplicité des expériences humaines face à l'oppression et à la discrimination.
-
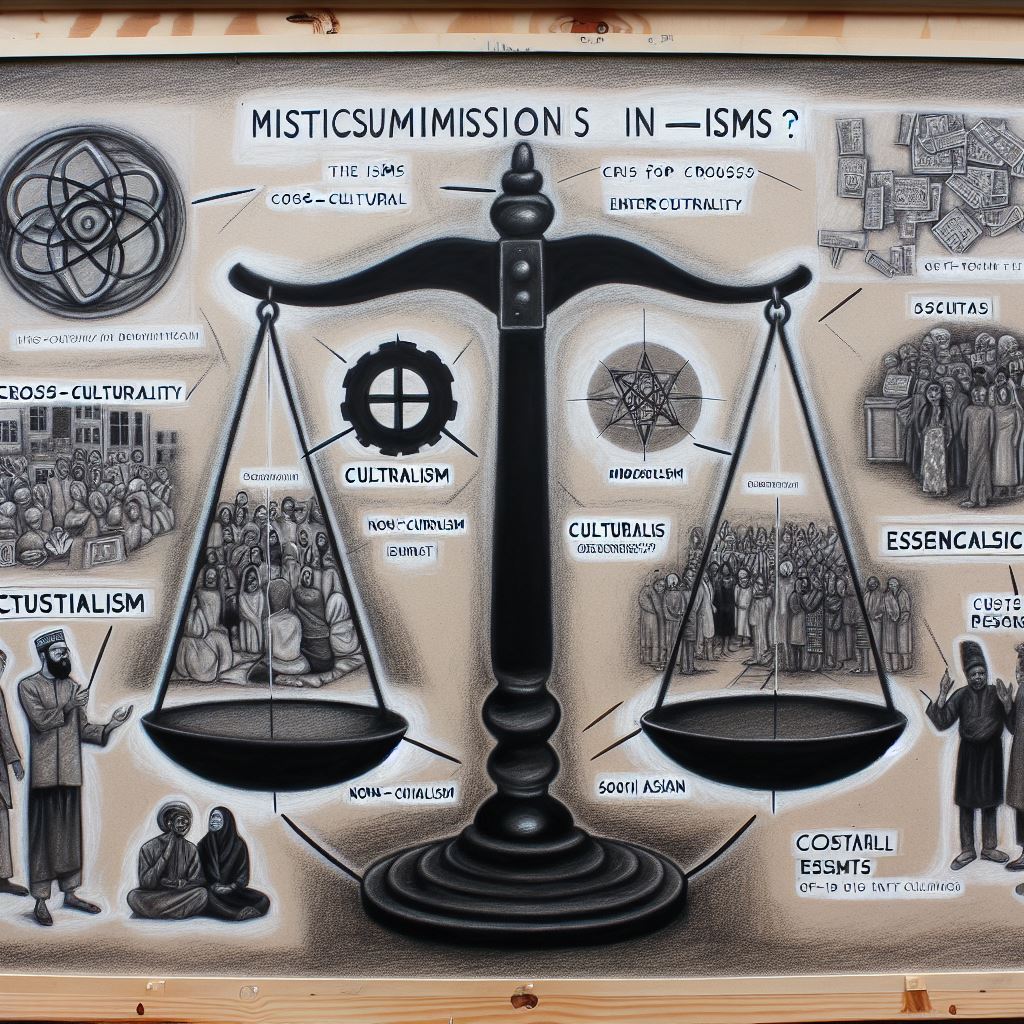
Le terme « -ism » désigne un élément de formation de mots qui crée des noms évoquant une doctrine, une idéologie ou un système. Les -isms englobent des croyances et des pratiques pouvant avoir des conséquences négatives significatives sur divers groupes, tels que le racisme, le sexisme, le classisme et l'ableisme. Ces concepts, issus des racines latines et grecques, sont souvent perçus de manière critique dans le monde contemporain.
-
