Les trois mécanismes d'hégémonie – coercition, prescription et co-optation
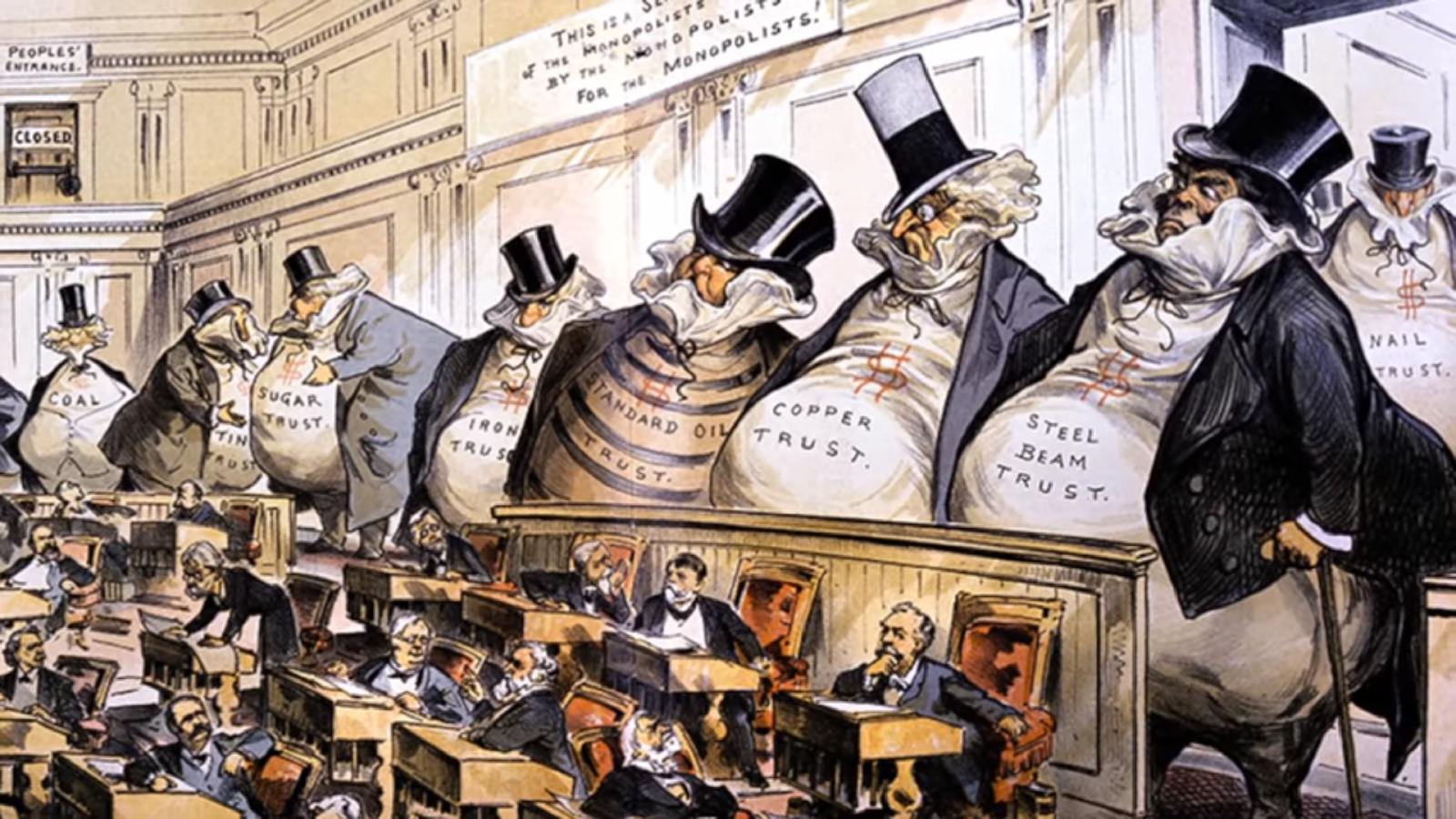
L'étude se concentre sur la période 2000-2021, marquée par une intensification des tensions entre l'UE et la Russie pour influencer les politiques moldaves et arméniennes. Les deux puissances régionales cherchent à imposer leur modèle politique, économique et culturel aux pays voisins, mais elles le font de manière différente. L'UE utilise principalement un cadre institutionnalisé basé sur des récompenses conditionnelles (accès au marché européen, aide financière), tandis que la Russie recourt davantage à des menaces et sanctions économiques ou militaires.
Les résultats montrent que, malgré des différences initiales, les pratiques de l'UE et de la Russie ont convergé partiellement dans le temps, notamment après 2015, lorsque Moscou a commencé à utiliser des instruments prescriptifs via l'Union économique eurasiatique (UEE). Cependant, les deux acteurs continuent à exploiter ces mécanismes séparément, avec des nuances importantes dans leur mise en œuvre.
Évolution des activités hégémoniques
Période 2000-2008 : Une politique commune vers le voisinage
Dans cette première phase, l'UE et la Russie développent des politiques communes vis-à-vis des pays voisins. L'UE met en place sa Politique européenne de voisinage (PEV) en 2004, combinant coercition, prescription et co-optation dans un cadre institutionnalisé. Elle impose des réformes démocratiques et légales en échange d'avantages économiques et de coopération.
La Russie, quant à elle, reste plus discrète durant cette période. Ses actions reposent principalement sur la coercition, notamment en exploitant ses avantages militaires et énergétiques dans les conflits gelés comme celui de Transnistrie en Moldavie. Elle commence également à renforcer ses liens culturels via des programmes linguistiques et des centres culturels russes.
Différences clés :
- L'UE négocie ses conditions avec les pays voisins.
- La Russie impose ses exigences de manière unilatérale.
Période 2009-2014 : De la coopération à la compétition
Cette période marque un tournant important avec la création du Partenariat oriental (PO) par l'UE en 2009 et l'établissement de l'Union douanière eurasienne par la Russie en 2010. Ces initiatives reflètent une compétition croissante entre les deux puissances.
-
L'UE :
- Introduit des Accords d'association (AA) incluant des Zones de libre-échange profond et complet (DCFTA) pour encourager une intégration plus étroite.
- Renforce son approche prescriptive en demandant des adaptations législatives majeures, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire.
- Développe ses efforts de cooptation en soutenant les organisations de la société civile moldave et arménienne pour promouvoir les valeurs démocratiques européennes.
-
La Russie :
- Augmente ses pressions coercitives, notamment via des embargos alimentaires contre la Moldavie et l'Arménie pour les dissuader de signer des accords avec l'UE.
- Commence à prescrire des règles sanitaires et phytosanitaires (SPS) via l'Union douanière eurasienne.
- Intensifie ses efforts de cooptation culturelle, en particulier en diffusant des narratives qui disqualifient les valeurs occidentales comme menaçantes pour les traditions locales.
Événements clés :
- En 2013, l'Arménie abandonne les négociations pour un AA/DCFTA avec l'UE sous pression de Moscou et rejoint l'UEE en 2015.
- La Moldavie signe un AA/DCFTA avec l'UE en 2014, malgré des sanctions russes.
Période 2015-2021 : Vers une différenciation accrue
Après l'entrée en vigueur des AA/DCFTA moldave et l'adhésion arménienne à l'UEE, les stratégies de l'UE et de la Russie divergent davantage selon les contextes spécifiques des deux pays.
-
L'UE :
- Continue à appliquer sa stratégie institutionnalisée, en insistant sur la conformité législative et réglementaire moldave.
- Renforce ses efforts de communication pour contrer les narratives russes, notamment en Moldavie où les médias russes dominent.
- Soutient activement les CSOs moldaves et arméniennes, en les incluant dans les processus de décision nationaux.
-
La Russie :
- Concentre ses efforts coercitifs sur la sécurité arménienne et la dépendance énergétique moldave.
- Utilise directement les normes de l'UEE pour prescrire des règles aux producteurs agro-alimentaires moldaves et arméniens.
- Accentue son discours conservateur, présentant "l'Occident" comme une menace pour les valeurs traditionnelles, notamment religieuses.
Comparaison des mécanismes d'hégémonie
Coercition
-
L'UE :
- Privilégie une coercition positive via des récompenses conditionnelles (accès au marché, assistance financière).
- Met en œuvre des sanctions limitées, surtout lorsqu'il y a un manque de progrès dans les réformes (ex. suspension de l'aide macro-financière moldave).
-
La Russie :
- Recourt à une coercition négative, souvent imprévisible et punitive (embargos, coupures de gaz).
- Exploite les vulnérabilités économiques et sécuritaires des pays voisins sans offrir de contrepartie significative.
Perceptions locales :
- En Moldavie, les élites perçoivent les exigences européennes comme positives, même si coûteuses.
- En Arménie, les actions russes sont acceptées car associées à la sécurité nationale, mais elles suscitent des réserves après la guerre du Haut-Karabakh en 2020.
Prescription
-
L'UE :
- Prescrit des règles strictes centrées sur des processus sûrs dans la production alimentaire (principe HACCP).
- Oblige les partenaires à harmoniser leur législation avec celle de l'UE, même pour les produits destinés au marché domestique.
-
La Russie :
- Via l'UEE, prescrit des normes axées sur la qualité des produits finis plutôt que sur les processus.
- Demande aux exportateurs moldaves et arméniens de respecter les Technical Regulations (TRs) eurasiennes, bien qu'incompatibles avec les standards européens.
Difficultés d'application :
- En Moldavie, la transition vers les normes européennes est facilitée par des programmes de formation et d'assistance technique.
- En Arménie, l'application simultanée des normes de l'UEE et de l'UE crée des incertitudes juridiques et des problèmes pratiques pour les entreprises locales.
Cooptation
-
L'UE :
- Promeut la diversité culturelle et les valeurs démocratiques universelles via des projets artistiques, des programmes éducatifs (Erasmus+) et un soutien aux CSOs.
- Encourage la mobilité transfrontalière, notamment grâce à la libéralisation des visas moldaves.
-
La Russie :
- Exploite ses liens historiques et culturels hérités de l'empire soviétique (langue russe, Église orthodoxe).
- Intensifie ses programmes linguistiques et culturels, tout en Othering "l'Occident" pour renforcer son identité en opposition aux valeurs européennes.
Perceptions locales :
- En Moldavie, la promotion de la langue russe est contestée, car perçue comme une menace pour l'identité nationale.
- En Arménie, les initiatives russes sont mieux acceptées en raison des liens religieux et historiques étroits.
Analyse diachronique
Convergence partielle
Au fil du temps, les mécanismes d'hégémonie utilisés par l'UE et la Russie convergent partiellement :
-
L'UE :
- Adopte une position plus ferme, en sanctionnant effectivement les gouvernements qui ne respectent pas ses conditions.
- Développe davantage ses instruments de cooptation, notamment en matière de communication publique et de diplomatie culturelle.
-
La Russie :
- Intègre la prescription dans sa boîte à outils grâce à l'UEE.
- Amplifie ses efforts de cooptation idéologique en opposant les "valeurs traditionnelles" aux "valeurs néolibérales" européennes.
Divergences persistantes
Malgré cette convergence partielle, plusieurs différences subsistent :
- Institutionnalisation : L'UE combine ses mécanismes dans une stratégie cohérente et interconnectée, tandis que la Russie continue à les utiliser de manière séparée.
- Normativité : L'UE justifie ses actions par des arguments normatifs (démocratie, droits humains), alors que la Russie s'appuie sur des valeurs conservatrices et une identité post-soviétique.
Résultats principaux
Coercition
- La coercition russe repose sur des menaces unilatérales et réactives (embargos, présence militaire), tandis que l'UE utilise une coercition positive basée sur des récompenses conditionnelles.
- En Moldavie, l'UE réussit à renforcer sa crédibilité en exécutant ses menaces (ex. suspension de l'aide macro-financière).
- En Arménie, la perception de la Russie comme allié sécuritaire limite les effets des critiques envers ses actions coercitives.
Prescription
- L'UE dispose d'un système de règles plus cohérent et développé, axé sur des processus sûrs.
- La Russie, via l'UEE, adopte des normes hybrides qui combinent des éléments hérités du passé soviétique et des standards internationaux.
- Les entreprises moldaves et arméniennes doivent souvent gérer des normes incompatibles (UE vs UEE), ce qui complique leur activité commerciale.
Cooptation
- La Russie bénéficie d'un avantage culturel hérité de l'ère soviétique, notamment en termes de langue et de religion.
- L'UE peine à diffuser ses valeurs démocratiques hors des cercles des élites pro-européennes.
- En Arménie, les efforts russes de cooptation sont mieux acceptés que ceux de l'UE, en raison des liens historiques forts.
Conclusion
L'analyse montre que, bien que l'UE et la Russie aient progressivement adopté des mécanismes similaires (coercition, prescription, cooptation), leurs approches demeurent fondamentalement différentes :
- L'UE cherche à obtenir un consentement implicite via des structures institutionnelles et des récompenses.
- La Russie s'appuie sur des asymétries historiques et économiques pour imposer son influence.
Les perceptions locales jouent un rôle crucial dans l'efficacité de ces mécanismes. Par exemple :
- En Moldavie, l'UE est perçue comme un partenaire attractif malgré ses exigences coûteuses.
- En Arménie, la Russie conserve une position privilégiée, même si sa crédibilité est mise à l'épreuve après la guerre de 2020.
Enfin, les résultats suggèrent que la différence entre l'influence de l'UE et de la Russie devrait être vue comme une question de degré plutôt que de nature. Les deux acteurs cherchent à étendre leur influence, mais leurs méthodes varient selon les contextes locaux et leurs capacités respectives. Cette étude invite ainsi à une compréhension nuancée des dynamiques de pouvoir dans le voisinage partagé.
