Cadre théorique
Conditions d’achèvement
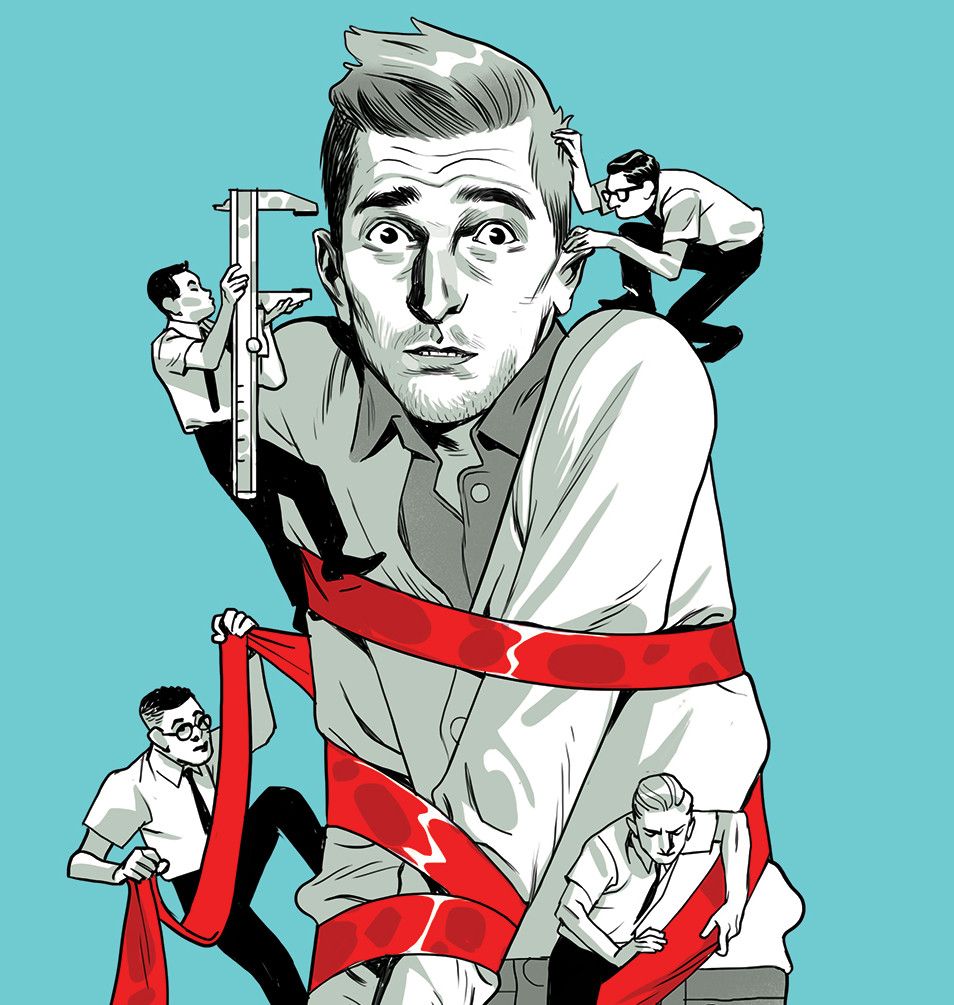
-
Histoire et héritage :
- L'influence russe dans les pays post-soviétiques repose sur un héritage impérial et soviétique marqué par un contrôle centralisé, notamment en Europe de l'Est, au Caucase et en Asie centrale.
- La fin de l'Union soviétique a permis l'émergence de nouvelles nations qui ont souvent construit leur identité nationale en opposition à la domination russe.
- En revanche, l'UE a établi son influence principalement via son processus d'élargissement et sa politique de voisinage, promouvant ses normes démocratiques et économiques.
-
Concepts théoriques :
- Le document introduit le concept d'« hégémonie » comme stratégie des puissances régionales pour exercer leur influence sans recourir constamment à la violence.
- Trois mécanismes clés d'hégémonie sont identifiés :
- Coercition : Utilisation de menaces ou de sanctions pour forcer un État à agir contre ses intérêts.
- Prescription : Imposition de règles et standards sectoriels qui influencent le comportement des États voisins.
- Co-optation : Réshaping des idées, valeurs et croyances pour obtenir le consentement des acteurs locaux.
-
Évolution des relations entre l'UE et la Russie :
- Jusqu'en 2014, certains pays comme l'Ukraine et la Moldova ont adopté une « double orientation » (vers l'UE et la Russie).
- Après l'annexion de la Crimée et le début du conflit en Ukraine, cette dualité s'est effondrée, exacerbant la compétition entre l'UE et la Russie.
Analyse des mécanismes d'influence
1. Coercition
- L'UE :
- Utilise une conditionnalité institutionnalisée, imposant des réformes aux pays partenaires en échange de récompenses telles que l'accès au marché européen.
- Ses outils coercitifs sont formalisés et progressifs, basés sur des accords bilatéraux.
- La Russie :
- Recourt à des moyens informels, tels que des restrictions commerciales ou des pressions économiques directes.
- Exemple : En 2013, la Russie a imposé des embargos alimentaires à l'Ukraine et à la Moldova pour les dissuader de signer des accords avec l'UE.
2. Prescription
- L'UE :
- Développe des règles et standards sectoriels stricts, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, qui influencent les politiques des pays voisins.
- Les accords de libre-échange profond et complet (DCFTA) obligent les partenaires à harmoniser leurs législations avec celles de l'UE.
- La Russie :
- À travers l'Union économique eurasiatique (UEE), elle impose également des normes communes, bien que celles-ci diffèrent souvent des standards européens.
- Exemple : La Russie a modernisé son système de sécurité alimentaire pour répondre aux exigences de l'OMC tout en maintenant des pratiques plus prescriptives.
3. Co-optation
- L'UE :
- Promeut des valeurs démocratiques et libérales pour attirer les élites locales et la société civile.
- Utilise des programmes culturels et éducatifs pour renforcer son attractivité.
- La Russie :
- S'appuie sur des liens historiques, linguistiques et religieux pour coopter les sociétés post-soviétiques.
- Propage une idéologie conservatrice en réponse aux valeurs occidentales perçues comme menaçantes.
Études de cas : Moldova et Arménie
-
Moldova :
- Envers l'UE : La Moldova a signé un Accord d'association (AA) avec l'UE en 2014, ce qui a conduit à une forte approximation législative avec le droit européen.
- Envers la Russie : Malgré cela, la Moldova reste tributaire du marché russe pour ses exportations agricoles et conserve des liens étroits avec Moscou.
-
Arménie :
- Envers l'UE : En 2017, l'Arménie a signé un Partenariat renforcé avec l'UE, mais sans inclure un accord commercial complet en raison de son adhésion à l'UEE.
- Envers la Russie : L'Arménie est fortement dépendante de la Russie pour sa sécurité, notamment dans le cadre du conflit avec l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh.
Évolution temporelle (2000-2021)
-
Période 2000-2008 :
- L'UE prépare son élargissement à l'Est, tandis que la Russie cherche à renforcer son influence dans la région sous Vladimir Poutine.
- Emergence de nouvelles initiatives comme la Politique européenne de voisinage (PEV).
-
Période 2009-2014 :
- Lancement du Partenariat oriental (PO) par l'UE pour renforcer ses liens avec les pays de l'Est.
- Création de l'Union douanière eurasienne (prédécesseur de l'UEE) par la Russie.
- Escalade des tensions autour de l'Ukraine, aboutissant à la crise de 2014.
-
Période 2015-2021 :
- Entrée en vigueur des accords UE/PO et de l'UEE, intensifiant la compétition pour l'influence.
- La guerre russo-ukrainienne marque une rupture majeure dans les relations UE-Russie.
Résultats et conclusions
-
Similitudes et différences :
- L'UE et la Russie utilisent les mêmes mécanismes d'hégémonie (coercition, prescription, co-optation), mais de manière différente :
- L'UE privilégie une approche institutionnalisée et progressive.
- La Russie préfère des méthodes informelles et sporadiques.
- Les perceptions locales jouent un rôle crucial : certaines élites et populations peuvent percevoir l'influence russe comme légitime en raison de liens historiques, tandis que l'influence européenne est souvent associée à des réformes démocratiques.
- L'UE et la Russie utilisent les mêmes mécanismes d'hégémonie (coercition, prescription, co-optation), mais de manière différente :
-
Convergence ou divergence ? :
- Depuis 2014, les stratégies de l'UE et de la Russie semblent converger vers une utilisation accrue de moyens similaires (ex. communication idéologique, concurrence économique).
- Cependant, leurs justifications normatives restent fondamentalement différentes : l'UE se présente comme un promoteur de valeurs universelles, tandis que la Russie défend une vision conservatrice et nationaliste.
-
Recommandations :
- Pour mieux comprendre les dynamiques de pouvoir dans le voisinage partagé, il est nécessaire de dépasser les dichotomies simplistes entre « soft power » et « hard power ».
- Une analyse comparative des mécanismes d'hégémonie permet de révéler les nuances et les similitudes entre les stratégies de l'UE et de la Russie.
Conclusion générale
Ce travail montre que malgré leurs différences apparentes, l'UE et la Russie partagent des similitudes dans la manière dont elles exercent leur influence dans leur voisinage partagé. En utilisant des concepts génériques comme ceux d'hégémonie et de pouvoir, l'auteur propose une analyse comparative qui enrichit notre compréhension des relations internationales dans cette région complexe et en évolution constante.
Modifié le: dimanche 2 mars 2025, 16:26
